“I AM BURIED HERE.YOU CAN RESURRECT ME BUT ONLY PIECEMEAL. IF YOU WANT TO SEE THE WHOLE YOU WILL HAVE TO SEW ME TOGETHER YOURSELF.”
Shelley Jackson, Patchwork Girl (1995)
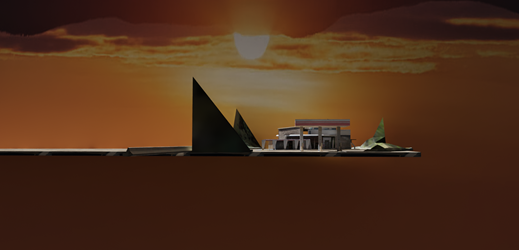
Le film est centré sur le personnage de Christine, une jeune femme blonde, blanche, culturellement bourgeoise, à la recherche d’un travail. Son amie, jouée par la photographe Nan Goldin, lui prête un rouge-à-lèvre. Christine relève le nom amusée, Sin City. C’est ainsi que lorsque Christine se met à vendre des tickets d’entrée pour un cinéma diffusant des films pornographique, on y voit l’accomplissement de cette prophétie-fantasme, celle d’une blanche brebis, précarisée par sa recherche de travail, que les bas-fonds de la ville vont corrompre à jamais. Tous les ingrédients sont réunis pour une expérience de film un peu misogyne dont l’histoire du cinéma est déjà pavée. Une dont on connaît déjà la fin, la Belle de jour se fait digérer par la ville, par les Hommes et leur regard…
On la regarde lutter contre ce nouvel environnement, derrière son comptoir en verre. Son jeu en revanche nous empêche d’aller complètement dans ce sens. Le film rejette déjà l’idée d’accorder un quelconque pouvoir corrupteur aux yeux des hommes. Ceux-ci sont simplement une extension de la condition matérielle féminine, une réalité tangible et donc évitable.
On perçoit un plaisir dans son regard à elle, une indépendance qui nous est complètement inaccessible. Elle ne subit pas ses désirs, on la voit chercher à les comprendre, les digérer en pleine conscience. Elle commence à prendre sa pause dans le hall du cinéma où elle peut écouter les sons des films en fumant une cigarette ou deux.
Tout du long, la caméra se prête à ses yeux. Des plans très sobres, souvent de loin, montrant assez objectivement tout ce dont elle est consciente. Les miroirs rendent ambigus ce point de vue, minimisant parfois le degré de conscience qu’elle a de ses alentours. Des plans d’hommes qui la regardent de dos sont subvertis par un simple mouvement de caméra révélant qu’elle choisit simplement de les ignorer, en pleine conscience de leur présence.
Le son içi agit comme l'élément perturbateur, représentant un monde auquel on n’a pas tout à fait encore accès. Beaucoup de sons d’ambiances sont dérivés du fait qu’on les entends de l’extérieur. Là encore le film bénéficie du petit budget. Les sons sont feutrés, sans sources, l’image texturée. C’est par le son que les éléments néo noirs s’infiltrent au départ, avec un jazz extra diégétique tandis qu’elle s’enfonce dans la nuit. Les codes du film noir remplissent les trous, façonnent notre perception et nos attentes. Les visages sont assez peu éclairés, laissant les nombreuses visions de néons publicitaires arracher notre attention.
Outre la conspiration centrale du film, il y a tout un monde parallèle, en marge de l’action, que l’on peut accéder qu’en se tournant vers les textures, et la faillibilité de nos sens. Ce monde existe une couche en dessous du domestique, du familier, et l’on observe Christine être attirée par ces trous dans le tissu du film où il est perceptible.
Au fur et à mesure de cette transformation, le langage filmique est bouleversé. Il ne trahit pas le point de vue de la protagoniste car c’est son sens de soi qui évolue. On voit la caméra s’attarder un peu plus longtemps sur les peaux, la texture du sol. Elle est beaucoup plus recentrée, car Christine se défait des couches d’hyper-conscience et de méfiance qui façonnaient son rapport au monde. Elle perd en lisibilité, est inondée par les couleurs, les lumières.
On lit un ressentiment grandissant, alors que la protagoniste voit les différents objets devenir commodifiés et digérés par le paysage urbain. The coke is it. The coke is here. Come get your pleasure here, you will find the pleasure here. Elle se met à envier, ou au moins à vouloir comprendre cette figure mystique qui semble échapper à toute objectification. Cet homme blanc cis hétéro qui fait des avances aux vendeuses et paye sans compter les deux dollars d’admission, et parle des films comme s’il s’agissait de simples distractions, créés à son intention. Il glisse dans la ville, flottant au-dessus sans friction. C’est son terrain de jeu, quand pour elle il s’agit d’une cage, ou plutôt de cette petite boîte vitrée où elle doit vendre les entrées et demander avant d’aller aux toilettes.
En le regardant, elle gagne du pouvoir et de la liberté. Elle transcende l’échelle de la rue et devient consommatrice plutôt que consommée. En devenant la faiseuse d’image, elle transcende l’échelle de la rue, devenant productrice plutôt que consommatrice ou consommée.
Une image lui vient lorsqu’elle est allongée sur le divan de sa psychothérapeute. Elle est témoin, des dizaines d’hommes, connectés par cette poignée de main. Des mains, passant l’argent contre des billets d’entrée, des mains qui se tiennent, se serrent. Tout est connecté, de l’homme d'affaires au vendeur de poisson. La monnaie d’échange est la sensation passagère du contact contre sa peau, sa peau à elle. Le thérapeute lui demande de relâcher. La main de l’homme qui tente de la saisir à travers l’ouverture de sa cage en verre, cette main en serre une autre, et une autre, et une autre.
Cette métamorphose ne vient pas sans prix, on la voit faillir à son rôle de vendeuse de tickets, ses amies ne l’ont pas vue depuis des semaines, les messages inquiets de sa mère s’accumulent dans le répondeur, son admirateur s’est lassé d’elle. Progressivement Christine s’absente des moments de discussions entre femmes, moments qui rythment le film, articulant sa pensée politique. De par son nouveau rôle, elle existe dans cette friche inconfortable, exclue des espaces féminin, et ignorée par le monde des hommes. Elle existe entre deux mondes, entre deux genres, concentrée sur sa recherche de ces nouvelles images.
La cassette VHS sur laquelle j’ai re-regardé ce film occulte beaucoup de l’image. Elle noie les zones d’ombre dans un bleu vert qui grouille et tressaute avec l’image, ce qui semble particulièrement à propos pour un film aussi fasciné par la physicalité du médium. Le film fait référence à tout un pan du cinéma qu’on pourrait considérer comme appartenant au “body genre”. Selon Richard Dyer il s’agit des films qui par l’image cherchent à impliquer physiquement l’audience. Le cinéma d’horreur en faisant sursauter, les films à l’eau de rose en tirant les larmes, et le cinéma pornographique en faisant éjaculer. Cette distinction est accompagnée d’un appauvrissement de l’image critique de ces films. En créant un choc physique, ces images rompent le besoin d’accompagner la pensée du spectateur à travers une narration ou des images. A la place le corps est travaillé à même la peau, un peu à la manière de la techno ou de la noise avec leurs fréquences assez fortes pour faire tressauter les corps et les sols.
*
L’écriture de Kathy Acker a quelque chose de fluide. Chaque mot est pesé par rapport à la réaction qu’il infère chez celle qui le lit. Elle encadre, dirige notre attention en taillant dans le mou. Les images conjurées dans l’esprit marquent la tonalité. On lit, un peu horrifiée, à mesure que notre compréhension du monde s’écroule à nos pieds. Lire Sang et Stupre au lycée a quelque chose d’une indigestion interminable. On s’accroche aux textures, regardant la narration dégringoler dans une sorte d’ivresse contrôlée. Une cacophonie contrôlée où la perte de repère devient un rythme à lui-même. Le fil de la narration qui dégouline, retenu par des moments de prose beaucoup plus distants, des moments de respiration. On est tenues à la gorge.
*
Variety pointe du doigt cette tension entre support et réceptacles. Lors de sa première pause cigarette, Christine rentre dans la cage de projection, à même le bruit. On ne voit rien, pas de trace de celluloïd ou même de VHS à l’écran, en revanche on entend. Les orgasmes factices se mêlent au ronronnement régulier des pellicules. Ces images, aussi dé valorisées soient elles sont matérielles. Il y a une sorte de magie à ce médium, entretenue par le fait que notre protagoniste n’a pas accès aux moyens de production. Alors elle fait avec ce qu’elle a. Elle se met à raconter monotonement à qui veut bien l’entendre des longues scènes érotiques inventées. Elle cherche ses mots comme si elle décrivait un rêve. Elle digère et restitue à voix haute. Des images brutes faites de ce qu’elle voit et ressent. Des images sans support pour le moment, qui flottent dans l’air, celui du bar, à côté du flipper. Des images qui en engendrent d’autres dans l’esprit de ceux qui les entendent, comme un virus qu’on propage.
>HELP ME I'M LOST